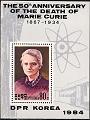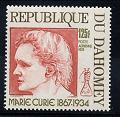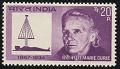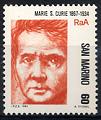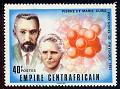Fils
d'un médecin protestant, Pierre Curie ne fréquente
d'abord ni école ni lycée. Ses parents,
son frère puis un professeur ami de la famille
se chargent de son instruction. Il rejoint finalement
la Sorbonne où il passe sa licence de physique à l'âge
de dix-huit ans. En 1880, il observe en collaboration
avec son frère un phénomène important
baptisé "piézo-électricité" selon
lequel une pression exercée sur un cristal de
quartz crée un potentiel électrique. En
1882, Pierre Curie est nommé chef de travaux à l'Ecole
de physique et de chimie industrielle de Paris. Il travaille
d'abord sur la symétrie et les répétitions
dans les milieux cristallins puis s'intéresse
au magnétisme. Dans sa thèse sur les
Propriétés magnétiques des corps à diverses
températures, il énonce la loi de Curie
et définit le point de Curie, température
au-delà de laquelle certains matériaux
perdent leurs propriétés magnétiques.
Ces travaux lui valent une chaire à l'Ecole de
physique et de chimie en 1895.
La
même année, Pierre Curie épouse Marie
Sklodowska, une jeune polonaise venue poursuivre ses études
scientifiques à la Sorbonne en 1892. Ayant obtenu
sa licence de physique deux ans plus tard, Marie Curie
est reçue à l'agrégation des sciences
physiques en 1896. Elle s'intéresse alors de près
aux récentes découvertes de Wilhelm
Roentgen sur les rayons X et d'Henri
Becquerel qui a découvert la radioactivité en
1896. Elle choisit comme sujet de thèse l'Etude
des rayons uraniques. Elle observe les rayonnements
du pechblende, minerai d'uranium, et découvre
que ceux-ci sont plus intenses que ceux de l'uranium
lui-même. Pierre Curie décide alors de mettre
fin à ses recherches sur le magnétisme
pour soutenir sa femme dans l'étude de ce phénomène.
En 1898, ils publient leurs premiers
résultats
et annoncent la découverte de deux nouveaux radioéléments :
le polonium et le radium. Les époux Curie passent
les quatre années suivantes dans leur laboratoire
de fortune. Leur but : extraire suffisamment de
radium pour en déterminer la masse atomique. C'est
chose faite en 1902 ; Marie présente le résultat
dans sa thèse de doctorat en 1903 et reçoit
la même année le prix Nobel de physique
qu'elle partage avec son mari et Henri Becquerel. Elle
est la première femme à recevoir un tel
prix. En 1904, Pierre Curie obtient une chaire de physique à la
Sorbonne et est admis en 1905 à l'Académie
des sciences. Mais en 1906, il meurt brutalement, écrasé par
un camion.
Marie
se retrouve seule avec ses deux filles, Irène
et Eve. Elle remplace Pierre à son poste de la
Sorbonne et poursuit l'œuvre commune. En 1911,
elle obtient le prix Nobel de chimie pour ses travaux
sur le radium et ses composés et devient ainsi
le premier scientifique à avoir reçu deux
prix Nobel. Pendant la Première Guerre Mondiale,
elle dirige les services radiologiques de l'armée.
En 1921, elle participe à la création de
la Fondation Curie, département des applications
médicales de l'Institut du radium, fondé dès
1914. Mais les expositions répétées
aux rayonnements du radium qu'elle subit depuis des années
ont finalement raison de sa santé. Marie Curie
décèdera d'une anémie dans un sanatorium
de Sancellemoz en 1934.
![]() :
31/07/2018
:
31/07/2018